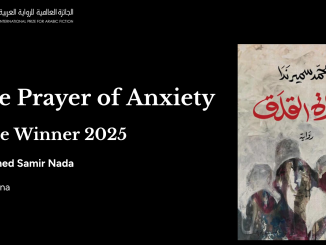La guerre des Six Jours de 1967 reste un tournant majeur du conflit israélo-arabe. En six jours, Israël a modifié la carte du Moyen-Orient, remporté une victoire militaire éclatante, mais ouvert une bataille politique et symbolique qui dure encore aujourd’hui.
Contexte de la guerre
Au printemps 1967, le Moyen-Orient est en tension extrême. Les États arabes voisins d’Israël – Égypte, Jordanie, Syrie – multiplient les menaces, tandis que l’URSS encourage la confrontation. L’expulsion des Casques bleus par Nasser et la fermeture du détroit de Tiran aux navires israéliens font monter la pression à son paroxysme. En juin, Israël prend l’initiative et lance une offensive éclair. En six jours, son armée écrase ses adversaires et modifie radicalement la carte régionale.
Les conséquences directes
La victoire militaire d’Israël est totale :
- Le Sinaï et Gaza sont pris à l’Égypte.
- La Cisjordanie et Jérusalem-Est passent sous contrôle israélien, après la défaite jordanienne.
- Le plateau du Golan est arraché à la Syrie.
Cette expansion triple quasiment la taille du territoire sous contrôle israélien et donne au pays une profondeur stratégique inédite. Pour la première fois, Jérusalem est réunifiée sous souveraineté israélienne. Mais cette victoire militaire contient en germe de nouveaux défis politiques.
La cristallisation du narratif arabe
Le sommet de Khartoum, en août 1967, scelle la ligne arabe : “trois non” – non à la paix, non à la reconnaissance, non aux négociations avec Israël. Dès lors, la récupération des territoires occupés devient le cœur du narratif arabe et palestinien.
Le terme “occupation” entre dans le vocabulaire politique mondial. Israël, qui se voulait dans son droit après une guerre défensive, devient désormais identifié à une puissance occupante. Cette perception nourrit l’hostilité internationale et structure durablement le discours palestinien.
L’héritage aujourd’hui
Près de six décennies plus tard, les conséquences de la guerre de 1967 continuent de peser :
- Gaza : évacuée en 2005 par Israël, elle est devenue une base du Hamas, symbole d’un retrait qui n’a pas apporté la paix.
- Cisjordanie : divisée entre zones autonomes palestiniennes et présence israélienne, elle reste au cœur des tensions.
- Jérusalem : la réunification de 1967 demeure un acquis majeur pour Israël, mais contesté par la communauté internationale.
- Le Golan : annexé par Israël en 1981, il a été reconnu par les États-Unis mais reste rejeté par la majorité des États.
La guerre des Six Jours est ainsi devenue un paradoxe : une victoire militaire éclatante, mais aussi le point de départ d’un conflit narratif qui n’a cessé de s’amplifier. Israël a gagné la sécurité stratégique, mais au prix d’une bataille politique et symbolique qui perdure jusqu’à aujourd’hui.
Pour conclure…
La guerre de 1967 a redessiné le Moyen-Orient. Elle a offert à Israël une puissance militaire et une assurance stratégique inédites. Mais elle a aussi figé la rhétorique arabe autour de “l’occupation”, un mot devenu central dans toutes les discussions sur le conflit. Comprendre 1967, c’est comprendre pourquoi Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem restent, près de soixante ans plus tard, au cœur de toutes les tensions régionales et internationales.
Lire aussi Le Moyen-Orient et la Seconde Guerre mondiale : un front oublié