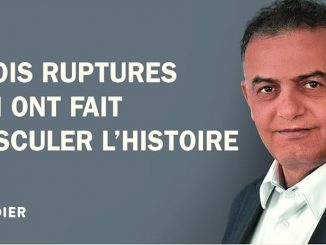Au-delà des clichés et des slogans, les sociétés du Moyen-Orient connaissent une transformation silencieuse : les femmes y deviennent les actrices d’un changement durable. Éducation, entrepreneuriat, diplomatie, culture : leur influence redéfinit les équilibres du monde arabe et annonce un nouvel âge de la modernité. Mais derrière cette « révolution tranquille », des inégalités persistantes et des voix dissidentes rappellent que l’émancipation reste sélective.
Une transformation profonde, sans rupture apparente… mais avec des ombres
Depuis une décennie, le rôle des femmes dans le Golfe s’élargit à un rythme inédit, porté par des réformes top-down plutôt que par des mouvements de rue.
Dans les Émirats arabes unis, elles représentent 77 % des diplômés universitaires (UNESCO, 2023), dirigent des institutions stratégiques comme la Bourse d’Abou Dhabi, et occupent 50 % des sièges dans les conseils d’administration fédéraux.
En Arabie saoudite, les décrets royaux de 2018 (droit de conduire) et 2019 (voyages sans tuteur masculin) ont multiplié par deux la participation féminine au marché du travail (Banque mondiale, 2024). Elles entreprennent, investissent et représentent désormais 33 % de la force de travail active.
À Bahreïn et Oman, des femmes occupent des postes clés : ambassadrices (Sheikha Rana bint Isa à Bahreïn), directrices de fonds souverains, ou chercheuses primées internationalement en biotechnologies.
Rien d’agressif ni de spectaculaire : le changement se fait sans drapeaux, mais avec méthode et quotas. C’est la marque de ce que beaucoup appellent désormais la “révolution tranquille” du Golfe.
Nuance essentielle : cette tranquillité a un prix. La tutelle masculine (wilaya) reste légalement en vigueur en Arabie saoudite, même assouplie. Aucune femme n’occupe de ministère régalien (Intérieur, Défense, Affaires étrangères). Au Koweït, aucune femme ministre depuis 2005. Au Qatar, une seule élue au Conseil consultatif. La modernité est graduelle au Sud, stagnante au Nord.
L’éducation comme levier de pouvoir… et de dépendance
Ce mouvement repose sur un choix stratégique : investir massivement dans l’éducation féminine comme moteur du développement national et de la diversification post-pétrole.
Aux Émirats, 77 % des femmes accèdent à l’université, souvent dans les sciences, le numérique, les relations internationales ou la finance durable. Ces diplômées nourrissent aujourd’hui l’économie de la connaissance, la diplomatie culturelle, les médias et les startups technologiques — comme Bayanat AI, cofondée par une Émiratie.
En Arabie saoudite, le programme Vision 2030 a ouvert des bourses internationales et des campus mixtes. Résultat : 60 % des étudiants en STEM sont aujourd’hui des femmes.
Ce n’est plus un débat idéologique mais une politique d’État : le leadership féminin est considéré comme un facteur de stabilité, d’efficacité et de soft power. La participation économique féminine dans le Golfe a doublé en dix ans, passant de 20 % à 40 % en moyenne (Banque mondiale).
Limite structurelle : près de 80 % des emplois féminins restent concentrés dans le secteur public, financé par la rente pétrolière. L’émancipation économique est réelle, mais dépendante de l’État.
Un soft power féminin en expansion… mais sous contrôle
Le monde découvre une nouvelle diplomatie arabe : plus pragmatique, moins idéologique, et souvent portée par des femmes comme :
- Reem Al Hashimy (Émirats) : ministre d’État, architecte de la COP28, visage de la transition verte.
- Haifa Al-Mogrin (Arabie saoudite) : première femme à diriger une mission permanente saoudienne à l’ONU.
- Lubna Al Qasimi (Émirats) : pionnière de la tech et ex-ministre du Commerce extérieur.
Ces figures incarnent une influence apaisée, fondée sur la compétence, la coopération et une modernité sans reniement identitaire. Leur narratif fascine jusqu’en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, où des délégations féminines du Golfe forment désormais des cadres locaux.
Dans la culture, les médias et les arts, cette dynamique se traduit par une autre narration du féminin arabe : créative, confiante et responsable, loin des caricatures occidentales comme des conservatismes locaux. Exemples : la cinéaste Haifaa Al-Mansour (Arabie saoudite), la plasticienne Latifa Echakhch (Émirats), ou les plateformes audiovisuelles comme MBC Hope, portées par des productrices.
Mais cette émancipation reste sélective. Les activistes qui ont réclamé ces droits avant les décrets royaux paient le prix fort :
- Loujain Al-Hathloul : emprisonnée de 2018 à 2021, libérée mais sous interdiction de voyage.
- Nassima Al-Sada (Qatif) : candidate aux municipales 2015, arrêtée, toujours en liberté conditionnelle.
Selon Human Rights Watch (2024), il s’agit d’une « liberté sous surveillance » : les femmes peuvent conduire, mais pas critiquer.
Une modernité enracinée… et inégale
La singularité du mouvement féminin du Golfe tient à son enracinement culturel et religieux. Ces sociétés n’opposent plus tradition et émancipation : elles les articulent via des fatwas progressistes, des conseils consultatifs mixtes, et une rhétorique de continuité. Cette approche graduelle – moderniser sans déstabiliser – donne aux femmes une légitimité sociale et politique durable.
Une manière de changer la société de l’intérieur, sans la fracturer ?
Mais la fracture existe ailleurs :
- Au Koweït, les femmes votent depuis 2005, mais aucune n’a été ministre depuis 2009.
- Au Qatar, une seule femme siège au Conseil consultatif (sur 45 membres).
- À Bahreïn, des militantes chiites comme Hajar Mansoor restent emprisonnées pour « incitation à la haine ».
La « révolution tranquille » est réelle au Sud (Émirats, Arabie saoudite), fragile au centre (Bahreïn), et quasiment absente au Nord (Koweït, Qatar).
Le Moyen-Orient comme laboratoire d’avenir… contrasté
Ce que l’on observe aujourd’hui dépasse la question féminine : c’est un modèle de transformation endogène, fondé sur la connaissance, la cohésion sociale et la diversification, plutôt que sur la confrontation ou l’importation de modèles étrangers.
Les femmes en sont le visage le plus visible, et peut-être le plus prometteur. Ce n’est pas une révolution de slogans, mais une révolution de fond, méthodique, pragmatique et pacifique — celle d’un monde arabe qui avance… quand l’État le décide. Les femmes ne réclament pas toujours le pouvoir : certaines l’exercent. D’autres le contestent. Et c’est dans cette tension que se joue l’avenir.
Focus Moyen-Orient.fr
Dans le Moyen-Orient contemporain, les femmes incarnent un changement concret, porteur d’équilibre et d’avenir — une modernité sans rupture apparente, mais avec des silences assourdissants.
Sources
UNESCO ; Banque mondiale ; Vision 2030 ; Human Rights Watch 2024 ; Amnesty International ; déclarations officielles.
Lire aussi :
- Sport féminin en Arabie saoudite : vitrine de modernité ou soft power ?
- Éducation : la vraie révolution silencieuse du Golfe