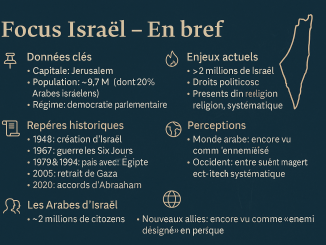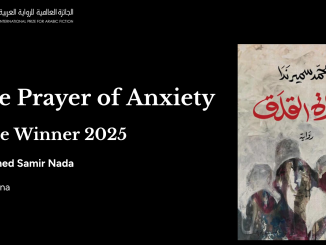États-Unis – Turquie : entre tensions et renaissance. Alliés au sein de l’OTAN mais souvent en désaccord, Washington et Ankara tentent de redéfinir leur partenariat. Entre contentieux militaires, ambitions énergétiques et nouveaux projets commerciaux, la relation turco-américaine entre dans une phase de réajustement stratégique.
Une alliance historique mise à l’épreuve
Depuis la Guerre froide, la Turquie et les États-Unis partagent un cadre d’alliance ancré dans l’OTAN. Mais au fil des décennies, les divergences se sont accumulées : guerre en Syrie, dossier kurde, relations avec la Russie, achat du système antiaérien russe S-400, et désaccords répétés sur la politique israélienne ou iranienne.
L’épisode du S-400 en 2019 a marqué un tournant : Washington a exclu la Turquie du programme F-35 et imposé des sanctions sous la loi CAATSA. Le climat de confiance s’est effrité, nourri par des différends bancaires (affaire Halkbank) et des visions régionales contradictoires.
Une relation contrainte, mais nécessaire
Malgré les tensions, ni Ankara ni Washington ne peuvent se permettre une rupture.
La Turquie reste un pivot géostratégique — entre Europe, Moyen-Orient et mer Noire — tandis que les États-Unis demeurent un partenaire économique et militaire essentiel.
Les deux pays cherchent donc à rétablir une forme de coopération pragmatique, où le commerce et la défense servent de leviers de rapprochement.
Le commerce, pilier d’un rapprochement pragmatique
Les deux capitales ont fixé un objectif ambitieux de 100 milliards de dollars d’échanges bilatéraux.
Déjà, plus de 2 000 entreprises américaines opèrent en Turquie, dans les domaines de la logistique, de l’énergie, des technologies et de la défense.
Les deux gouvernements misent sur l’innovation et les hautes technologies pour relancer la dynamique : intelligence artificielle, cybersécurité, industrie aéronautique et infrastructures vertes.
Ce virage économique traduit un réalisme partagé : la Turquie veut attirer des capitaux américains pour relancer sa croissance post-inflation, tandis que Washington cherche à ancrer Ankara dans l’orbite occidentale, face à la poussée russe et chinoise.
Défense : vers un nouvel équilibre
Le dossier F-16, symbole d’un rapprochement sous conditions
Après des mois de tractations, Washington a approuvé la vente de 40 avions F-16 et de kits de modernisation à Ankara.
Un geste politique autant que stratégique : il confirme la volonté de maintenir la Turquie au sein du dispositif aérien de l’OTAN.
Ankara a toutefois réduit le volume du contrat, préférant développer ses propres capacités industrielles — notamment le programme du chasseur KAAN, vitrine de l’autonomie turque en matière de défense.
Des perspectives conditionnelles pour le F-35
Certains analystes plaident pour un retour progressif de la Turquie dans le programme F-35, sous réserve d’un compromis sur les S-400 russes.
Ce scénario symboliserait une désescalade contrôlée, mais suppose un niveau de confiance que ni Washington ni Ankara ne jugent encore atteint.
Missiles et systèmes tactiques
Un contrat de 225 millions de dollars pour la fourniture de missiles air-air AMRAAM illustre la volonté américaine d’entretenir un canal technique minimal, garantissant interopérabilité et communication entre les deux armées.
L’énergie, nouvelle colonne vertébrale du dialogue
La guerre en Ukraine a replacé la Turquie au cœur des routes énergétiques.
Ankara aspire à devenir un hub gazier eurasiatique, reliant la Caspienne, la Russie et la Méditerranée.
Les États-Unis voient dans ce rôle une opportunité d’équilibrer l’influence russe tout en soutenant la diversification énergétique de l’Europe.
Les discussions portent désormais sur le gaz naturel liquéfié (LNG) américain et sur des projets d’interconnexion régionale.
Les défis structurels d’une relation inégale
- La méfiance politique : le Congrès américain demeure hostile à tout rapprochement trop rapide, notamment en raison des atteintes aux libertés en Turquie.
- L’autonomie stratégique turque : Ankara cherche à se détacher de la dépendance occidentale, développant drones, blindés et technologies nationales.
- La rivalité régionale : les positions turques en Syrie, en Libye ou en Méditerranée orientale entrent encore fréquemment en collision avec les intérêts américains.
- La diplomatie d’équilibriste d’Erdogan : oscillant entre Moscou, Washington et Pékin, Ankara cherche à maximiser ses marges sans rompre avec l’OTAN.
Vers une renaissance conditionnelle
Les signaux récents — ventes d’armes, projets commerciaux, coopération énergétique — traduisent un réchauffement tactique.
Les deux pays comprennent qu’une relation conflictuelle affaiblirait leurs positions respectives dans un Moyen-Orient en recomposition.
Mais la renaissance du partenariat américano-turc restera conditionnée à trois facteurs : la transparence industrielle, la gestion des alliances régionales, et la capacité d’Ankara à redéfinir son rapport à Moscou.
Alliances et intérêts mutuels fluctuants
Entre tensions persistantes et pragmatisme assumé, la relation américano-turque illustre la complexité du XXIᵉ siècle : les alliances ne se fondent plus sur la fidélité idéologique, mais sur des intérêts mutuels fluctuants.
Washington et Ankara, malgré leurs désaccords, n’ont jamais autant eu besoin l’un de l’autre :
la première pour contenir les dérives régionales, la seconde pour ne pas s’isoler des cercles de puissance occidentaux.
Lire aussi : Israël et la Turquie : un terrain d’entente possible en Syrie avec l’appui des États-Unis ?