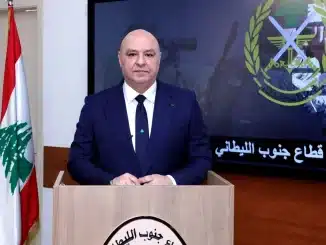Après le plan de Trump pour Gaza, une autre paix se dessine aussi ailleurs. Entre Israël et la Syrie d’Ahmed al-Sharaa, un dialogue discret émerge sous médiation américaine. Loin des illusions diplomatiques, cette « paix des marges » redéfinit la frontière nord et préfigure un nouvel équilibre régional. Israël–Syrie : la paix impossible ou la frontière réinventée ? Par Faraj Alexandre Rifai.
La paix viendra-t-elle des marges ?
La paix au Moyen-Orient d’après-guerre ne se redessinera peut-être pas à Gaza, mais ailleurs — là où les lignes de fracture se muent en lignes de contact. Depuis plusieurs mois, les signaux d’un rapprochement discret entre Israël et la Syrie post-Assad se multiplient.
Sur fond de médiation américaine, un nouvel équilibre se cherche : celui d’une stabilisation frontalière, surtout d’un dialogue sécuritaire et d’une diplomatie pragmatique et progressive, loin des discours et des conférences.
Cette dynamique, amorcée depuis la chute du régime Assad en décembre 2024 et l’arrivée au pouvoir du président Ahmed al-Sharaa, par les pressions américaines, n’est pas un traité de paix mais une forme de normalisation stratégique et sécuritaire. Et c’est peut-être ainsi que se joue le vrai futur du Moyen-Orient. D’autres formes de la paix seraient envisagées ?
Le précédent du Mont Hermon : le laboratoire d’une coexistence sous contrôle
L’accord en discussion sur le Mont Hermon, révélé fin octobre 2025, symbolise cette transformation.
Pour la première fois depuis 1974, Israël, la Syrie et les États-Unis envisagent une présence tripartite de surveillance sur la frontière. C’est éviter la guerre et les tension, à défaut d’installer immédiatement un traité de paix. Ce modèle — mi-militaire, mi-politique — sert d’expérimentation : établir une zone de sécurité gérée conjointement, prévenir le retour de milices iraniennes et créer un cadre minimal de dialogue.
Officiellement, les deux parties restent en guerre. Mais dans les faits, les échanges de renseignement, les contacts militaires indirects et la coordination via Washington tracent déjà les contours d’une paix fonctionnelle, sans traité ni cérémonie.
Une Syrie « post-Assad » en quête de légitimité
Malgré les signaux inquiétants — notamment les massacres de minorités alaouites et druzes —, le nouveau dirigeant s’efforce de projeter l’image d’un homme d’État pragmatique.
Sous pression américaine et saoudienne, il cherche à se repositionner comme un acteur légitime du nouvel ordre régional. Ses priorités : la reconstruction économique, la reconnaissance internationale et la sécurisation des frontières, un pari qu’il semble, du moins sur le plan diplomatique, avoir en partie réussi.
Dans ce cadre, le dialogue indirect avec Israël devient une monnaie d’échange. En montrant sa capacité à coopérer contre le reste de Daech, à contenir les milices islamistes, à éloigner la présence iranienne, et à stabiliser le sud syrien, Damas espère obtenir la levée progressive des sanctions américaines. Washington, de son côté, voit dans ce rapprochement avec Israël une manière de couper définitivement la route à Téhéran et d’isoler le Hezbollah.
Une normalisation sans drapeaux
Contrairement aux Accords d’Abraham, cette approche ne passe pas par la reconnaissance diplomatique, du moins pour l’instant. Elle repose sur une logique de normalisation technique :
- échanges de renseignements sur les trafics frontaliers ;
- prévenir tout mouvement de milices ou de groupes armés vers Israël ;
- maintien d’une zone tampon au sud du Golan.
Ces contacts discrets n’ont rien d’un traité de paix, mais ils produisent les effets d’un accord de stabilité. Israël, fort de son avance technologique et de son ancrage régional, agit sans illusion : il ne cherche plus la paix symbolique, mais la gestion sécuritaire. La diplomatie de façade a laissé place à la diplomatie des cérémonies et des drapeaux.
Les marges comme nouvelle géopolitique israélienne
En réalité, ce mouvement dépasse le cas syrien. Depuis l’accord de cessez-le-feu à Gaza, Israël et les États-Unis avancent sur plusieurs autres fronts :
- avec Riyad, un canal de coordination sécuritaire inédit autour du plan Trump pour Gaza ;
- avec le Liban, des pourparlers via Washington pour sécuriser la frontière nord et réduire les risques d’escalade avec le Hezbollah ;
- avec la Jordanie et les Émirats, une intensification des échanges en matière de renseignement et d’énergie.
Cette stratégie des marges repose sur un principe : consolider les périphéries pour neutraliser le centre. Gaza restera instable ; le reste de la région doit, lui, rester vivable.
Le pari américain : stabiliser sans imposer
Les États-Unis jouent un rôle clé. Washington alterne entre pressions fermes et gestes d’ouverture : ils l’ont fait avec la Syrie, comme ils le font avec Gaza et le Qatar. C’est une approche typiquement trumpienne, mêlant contrainte et pragmatisme, pour accompagner, mais aussi imposer, des changements au Moyen-Orient.
Par ailleurs, l’administration américaine sait que les populations locales sont lassées des grandes promesses. Elle préfère désormais miser sur la stabilité progressive : un cessez-le-feu qui tient, une frontière qui respire, un ennemi qui devient un voisin.
Dans cette logique, Israël et la Syrie ne signent pas la paix : ils apprennent à coexister.
Et cette coexistence, bien que fragile, sert les intérêts américains : un front nord pacifié, une influence iranienne contenue et une transition régionale pilotée sans confrontation ouverte.
La prudence israélienne
Pour Isarël, cette approche s’inscrit dans une vision cohérente : la sécurité avant la diplomatie, les marges avant les symboles. Le gouvernement israélien sait que la paix totale avec la Syrie est illusoire pour l’instant, mais la stabilité partielle serait déjà un succès.
En gérant le sud syrien, en dialoguant même discrètement avec l’Arabie saoudite, et en consolidant ses liens avec les États-Unis , Israël recompose son environnement sans renoncer à ses lignes rouges : pas de compromis sur le Golan, pas de retrait unilatéral, pas de dépendance diplomatique. C’est une paix pragmatique, réversible, mais réelle.
Conclusion : une frontière qui devient politique
La paix entre Israël et la Syrie ne sera ni solennelle ni romantique. Elle prendra la forme d’un réseau de coopérations, d’échanges, de limites assumées. Le Mont Hermon n’est pas un symbole de réconciliation, mais de cohabitation contrôlée — et c’est peut-être cela, le nouveau réalisme au Moyen-Orient ?
Le Moyen-Orient n’a pas besoin de nouvelles utopies. Il a besoin de frontières sécurisées, de voisins rationnels, et d’ennemis qui deviennent, parfois, des interlocuteurs. La paix ne viendra peut-être pas de Gaza, mais des marges où Israël apprend à transformer le conflit en équilibre.
Lire aussi : Accord Israël–Syrie : présence tripartite sur le mont Hermon